|
Saint
Bénigne de Dijon fut un monastère avant d'être une cathédrale.
La première église, construite sur la sépulture du
saint, date de 535. Le monastère est créé en 871. Lorsqu'il
constate, un peu plus d'un siècle plus tard, le délabrement
de l'église, l'abbé de Cluny
Maïeul décide de confier la reconstruction des bâtiments
à Guillaume de Volpiano. Les travaux sont entamés en 1001.
L'église de 100 m de long est alors la plus grande du monde chrétien.
Le monastère
prospère jusqu'à son passage sous le régime de la commende,
au début du XVIe siècle. Les bénédictins
de l'ordre de Saint Maur relèvent
le monastère au XVIIe siècle mais la Révolution vide
l'église de ses richesses, même si elle en épargne les
murs. Tout au long du XIXe, les bâtiments monastiques disparaissent
pour laisser place à de nouvelles constructions. |
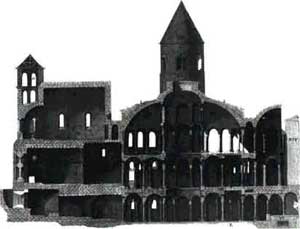
Rotonde de Guillaume de Volpiano
|
 |
La façade
de Saint-Bénigne est très austère. Le porche est
surmonté d'une galerie appelée galerie du Gloria (le prêtre
y bénit les rameaux). Au second niveau, on trouve une baie à
trois lancettes surmontées
d'une rose. Au-dessus une seconde galerie lie les deux tours qui flanquent
l'ensemble. Elle est coiffée d'un petit pignon.
Les deux tours, hexagonales, sont agrémentées de tourelles.
Malgré ses ornements, c'est le caractère massif de la façade
qui l'emporte.
Sous le porche,
on trouve un portail refait entre 1818 et 1822 : le tympan
représente Jésus chassant les marchands du temple et un
bas-relief relate la lapidation de Saint-Etienne. On ne peut que regretter
la disparition du portail roman.
|
| Le chevet de Saint-Bénigne a plus de charme que sa
façade, même si sa construction peut sembler maladroite. En
effet, les contreforts remplacent bien souvent des arc-boutants plus élégants,
par manque de place. Cependant, la flèche de 100 mètres de
haut (XIXe) et le toit multicolore (toit bourguignon) allègent l'ensemble. |
|
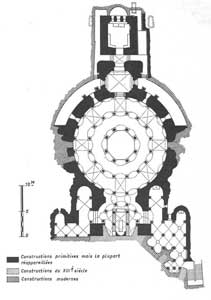 |
Le transept
ne se démarque pas des collatéraux
par sa largeur mais ses voûtes
sont plus hautes Le triforium qui court dans le transept est, comme celui
du choeur, plus travaillé
que celui de la nef. On peut faire la même remarque à propos
des chapiteaux, qui sont
sculptés dans le transept et dans l'abside
alors qu'ils ne le sont pas dans la nef. Cette rupture s'explique par
le manque de moyens financiers qui s'est fait plus pressant vers la fin
de la construction.
Le choeur,
qui ne comprend que deux travées, est construit dans une pierre
ocre, différente de celle utilisée pour le reste de l'édifice.
Les fenêtres hautes qui l'éclairent sont composées
de trois lancettes surmontées d'une rose.
Plan de la crypte
|
 |
Elle
est composée de l'étage inférieur de la rotonde
conçue par Guillaume Volpiano entre 1000 et 1003 (elle comportait
à l'origine trois étages), du martyrium et d'une chapelle.
La rotonde mesure 17 mètres de diamètre. Avant la destruction
des étages supérieurs de la rotonde, des ouvertures étaient
percées au niveau supérieur pour permettre l'éclairage
de la crypte. Cette source de lumière a aujourd'hui disparu. |
| La crypte est formée de trois cercles concentriques
délimités par de puissants piliers, ce qui donne l'impression
d'une forêt de colonnes. |
|
 |
On trouve quelques chapiteaux sculptés, dont certains mettent
en scène des orants.
Dans le martyrium, on peut voir la base du sarcophage de Saint-Bénigne
et des absidioles en cul-de-four (il y avait à l'origine une église
souterraine).
Exemple de chapiteau de la crypte (Atlante).
|
|
