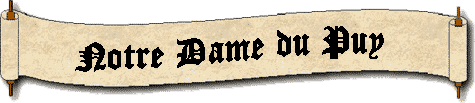|
Historique
 |
Le Puy-en-Velay est le lieu d'un ancien culte
païen, peut-être celte (on observe une influence
celtique sur la frise du chevet) ou orientale (les bas-reliefs
du chevet ont adopté des motifs orientaux). Plusieurs
légendes expliquent l'intérêt porté
par les chrétiens à cet endroit: une femme aurait
guéri, sur une dalle phonolithique (qu'on trouve aujourd'hui
dans l'église). Elle reçoit l'ordre céleste
d'avertir l'évêque saint Paulien de construire
une église au Puy. |
| On raconte aussi qu'un cerf (symbole de l'âme
aux prises avec les tentations du monde serait apparu pour délimiter
dans la neige les traces du sanctuaire. Enfin, des vieillards
auraient apporté aux évêques Vosy et Scutaire
les premières reliques de la vierge. Le Puy devient évêché
en 593. Jusqu'au IXe siècle, il n'y a pas de pèlerinage
vraiment important vers le Puy. A cette époque, le Puy
subit la rivalité de l'abbaye de Monastier. |
|
 |
En 950, l'évêque du Puy Godescalc
est le premier pèlerin à faire le chemin de
Saint Jacques de Compostelle.
Après son retour, le Puy devient le point de départ
de l'une des voies les plus importantes vers la Galice (via
Podiensis).
En 1051, l'évêque reçoit le pallium (le Puy est élevé
au rang d'archevêché). en 1077 commence un pèlerinage
suivi. Le Puy bénéficie d'abord d'une ferveur populaire
avant d'intéresser les puissants. Adhémar de Monteil, évêque
du Puy, est nommé chef de la première croisade en 1095 par
le pape Urbain II. Le culte se développe sous la protection des
rois et des papes qui font du Puy un bastion anti-cathare. De nombreux
conciles y sont tenus et les papes y effectuent plusieurs visites. Les
jubilés attirent les foules et de nombreuses indulgences sont attachées
au pèlerinage.
|
|
Saint Louis fait don d'une vierge reliquaire
originaire du Soudan qui est détruite à la Révolution
mais dont on a conservé une copie. Au XIXe siècle,
on assiste à un engouement du culte marial
qui aboutit à une reconnaissance du dogme de l'Immaculée
Conception. La cité ponote profite grandement de cette
vague qui persiste encore aujourd'hui.
La construction de la cathédrale actuelle
commence à la fin du XIe siècle. L'essentiel
des travaux est effectué au XIIe siècle. L'ancienne
église est utilisée comme chevet.
On lui ajoute un clocher, un transept
puis une nef
de deux travées.
Lors d'une deuxième campagne de travaux, deux autres
travées sont ajoutées avec un porche. Une troisième
campagne permet la construction des dernières travées
qui reposent sur des piliers dans le vide.
|
|
 |
Le porche du For est édifié
à la fin du XIIe siècle. Il est surmonté
d'une chapelle au XVIe. En 1427, un tremblement de terre rend
nécessaire l'ajout d'un gros arc-boutant dans la façade.
Celui-ci sera finalement enlevé à la fin du XIXe
siècle. Avant le XVIIIe siècle, l'entrée
de l'église se faisait par un souterrain qui débouchait
presqu'au niveau du choeur. Un nouveau passage est créé
par l'archevêque Gallard et provoque la fermeture de l'ancien
passage. Une entrée latérale est percée
au XIXe siècle. L'église qui menace ruine subit
alors de nombreuses restaurations pas toujours heureuses. |
| L'architecte Mallay détruit en 1845
une tour défensive du XIIe siècle qui était
reliée à la cathédrale par le bâtiment
des mâchicoulis. Il fait également disparaître
les fresques du croisillon sud. Son successeur, l'architecte
Mimey (1865) détruit le chevet et le reconstruit de façon
arbitraire. Entre 1885 et 1888, l'architecte Petitgrand reconstitue
le clocher pyramidal du chevet. Au XXe siècle, des travaux
ont permis de retrouver l'entrée initiale de l'église,
par un immense escalier débouchant comme une trappe au
coeur de la cathédrale. |
|
|