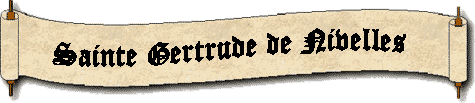|
Visite intérieure
 |
La nef
(de 20 mètres de haut) constitue la partie la plus ancienne
de l'édifice. Elle est composée de trois vaisseaux
séparés par des piliers carrés sans chapiteau
qui supportent des arcades cintrées. |
|
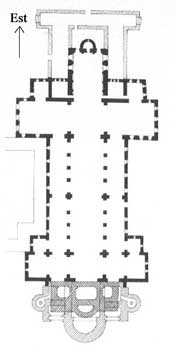 |
Au second niveau, on trouve une baie cintrée
par travée.
Les huit travées sont séparées en deux
groupes par un arc diaphragme qui soutient la charpente. On
trouve des arcs semblables à chaque extrémité
de la nef. |
|
 |
Les collatéraux
ont été voûtés de briques sur croisées
d'ogives
au début du XVIe siècle. Ils sont éclairés
par des baies cintrées et n'ouvrent sur aucune chapelle
latérale. |
|
| Le transept
ouest est moins élevé et moins saillant que le
transept oriental et la nef. Les murs de fond sont percés
de deux fenêtres cintrées. A la croisée
du transept, les murs qui prolongent ceux de la nef centrale
sont percés de deux minuscules baies, très haut
placées. |
|
 |
L'abside
ouest se greffe sur un ample volume de plan carré couvert
d'une coupole sur pendentifs.
|
|
 |
Celles-ci sont divisées en deux travées
chacune et reliées par un passage le long de l'abside.
|
|
 |
Au troisième étage (correspondant
au quatrième niveau de la façade),
on trouve une grande salle haute couverte par trois coupoles
sur pendentifs. Il s'agit de la salle impériale, dans
laquelle on peut voir une réplique de la châsse
de Sainte Gertrude du XIIIe siècle, presque entièrement
détruite dans le bombardement de 1940. |
| Le chœur oriental est orné de deux
niveaux d'arcatures aveugles, dans la première travée.
Au premier niveau, les arcs retombent en alternance sur des
piles carrées ou sur des colonnettes polygonales. |
|
 |
Au deuxième niveau, on trouve des bandes
lombardes. Ces bandes sont remplacées dans la deuxième
travée par de grandes fenêtres cintrées.
Le chevet plat est percé de trois larges baies également
cintrées. Le chœur était au XIe la seule
partie couverte par une voûte d'arêtes et non une
charpente. Cette voûte a subsisté. |
| La croisée du transept occidental
est de plan barlong.
Sur les bras de ce transept s'ouvrent deux chapelles orientées
vers l'est. |
| Sous le chœur, on trouve une
crypte
de 22 mètres sur 10,5 qui bénéficie d'un
éclairage direct. Spacieuse et claire, elle est voûtée
d'arêtes. |
|
 |
Elle s'organise en trois vaisseaux
de six travées séparées par des colonnes
polygonales aux chapiteaux cubiques, caractéristiques
du style
ottonien.
|
| Le corps de Gertrude ne se trouvait pas dans
la crypte, mais dans le chœur, abrité au sein d'une
splendide châsse.
Les pèlerins qui passaient dans la crypte se plaçaient
donc sous le corps pour l'adorer. |
| Le sous-sol archéologique de la collégiale,
mis au jour après les bombardements de 1940, est unique
en Europe, car il présente les restes des précédentes
constructions mérovingiennes (VIIe siècle) et
carolingiennes. On voit ainsi les couches superposées
de cinq églises, construites les unes après les
autres, et l'agrandissement progressif du plan. On s'aperçoit
également que l'église actuelle est construite
au-dessus des vestiges antérieurs, enfouis dans un important
remblayage. |
|
 |
Dans ce sous-sol, on trouve de très
nombreux caveaux, qui abritaient, pour certains, d'illustres
restes, attestant du prestige de Nivelles. Ainsi observe-t-on
le squelette d'une grande femme nommée Himeltrude ("fidèle
au ciel"), peut-être la première femme de
Charlemagne. A Nivelles était également enterrée
Ermentrude, petite-fille d'Hugues Capet. |
|